Le patrimoine de Chéraute
- Accueil
- Le patrimoine de Chéraute
LE PATRIMOINE
Les monuments

Le chateau
Construit avant la moitié du XVe siècle, le château de Chéraute est connu pour avoir été la propriété de Diane de Poitiers, née en 1499.
Construit d’un seul tenant, le château est notoire pour avoir été l’une des propriétés de Diane de Poitiers. Célèbre pour sa beauté et favorite du roi Henri II, elle y vit peu de temps avant sa mort, en 1566. Par la suite, le château appartient à la famille des Bela-Chéraute, durant le XVIIe siècle.
Aujourd'hui, le bâtiment est transformé en logements à loyer modéré, géré par l'Office 64 (Bayonne).

L'église Saint-Barthélemy
L'église Saint-Barthélemy, dont les origines remontent à la fin du Moyen Âge, a été agrandie à la fin du XIXe siècle. Son clocher et son porche ont été reconstruits au début du XXe siècle.
C'est un exemple d’architecture souletine. Elle contient aussi un beau retable, de style oloronais.
Une inscription gravée au-dessus d’une porte de l’église situe son origine au Moyen Âge. On note aussi, sur le linteau de la porte Nord, un symbole gravé. Ce sont des lettres grecques, X et P, soit les deux premières lettres du mot Christ en grec. Cette inscription, dite chrisme, sert d’emblème au christianisme depuis Constantin Ier, premier empereur romain à s’y être converti.
Lorsque l’église s’agrandit, en 1880, son plafond est remplacé par une voûte et des verrières sont ajoutées par un peintre-verrier d’Oloron.
L’édifice est en croix latine et doté d’une nef unique. Au début du XXe siècle, le clocher-porche est reconstruit par un architecte et un entrepreneur mauléonnais. Le toit de celui-ci est surmonté d’une flèche polygonale.
L'église possède un élégant autel secondaire exclusivement dédié à la Vierge. Il est centré sur une statue de la Vierge figurée debout et tenant l’enfant Jésus dans ses bras.
D’origine médiévale, le chœur de l’église Saint-Barthélemy est grandement modifié et particulièrement embelli en 1880 quand son plafond est remplacé par l’actuelle voûte peinte en ciel étoilé.

Les deux pièces principales du mobilier de l’église de Chéraute sont le retable et le tabernacle. Ils datent tous deux du début du XVIIIe siècle, époque du style baroque en France.
L’église Saint-Barthélemy possède des tribunes en bois typiques des églises basques et devenues aujourd’hui une affirmation identitaire. Selon la tradition basque, les hommes doivent être séparés des femmes durant les messes.

La chapelle trinitaire
La chapelle trinitaire de Notre-Dame de Hoquy a été construite par l'abbé Dominique Espaïn en 1936.

Fortification protohistorique de Gaztelaïa
Le camp protohistorique Gaztelaia est situé à Hoquy au sommet de la cote 479. Principalement fortifié sur ses faces Sud et Ouest, il comprend à l’ouest et à l’est une succession de deux fossés et deux parapets protégeant la partie sommitale. Le parapet supérieur est prolongé plus au Nord.
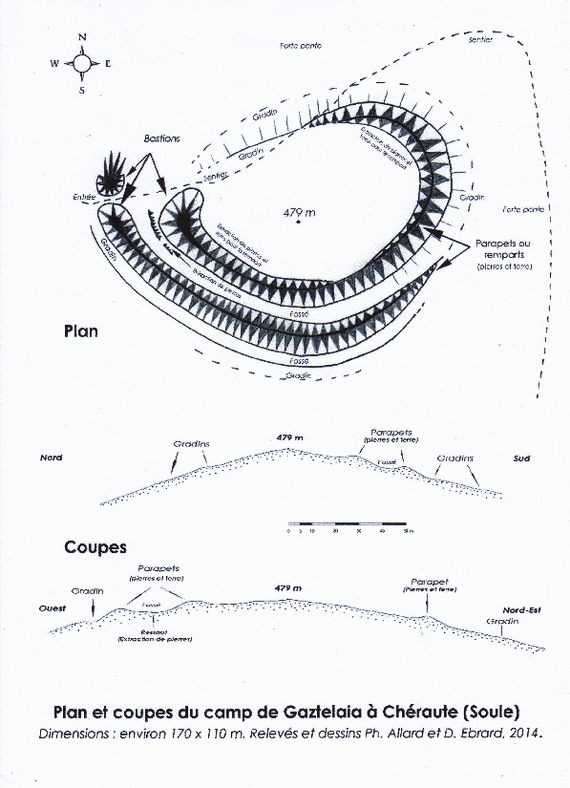
Un gradin prolonge le fossé n°2 vers l’Est jusqu’à rejoindre l’entrée supposée. Cette entrée, à la configuration incertaine, est protégée par deux premiers bastions, eux-mêmes dominés par un troisième bastion situé à l’extrémité Ouest du second parapet. La face Nord ne possède pas de parapet du fait d’une forte pente.
De même, la face Est n’est protégée que par un gradin et le second talus mais possède une forte pente. Le côté Sud, face au col, est lui le plus protégé.
- Le camp de Gaztelaia permet une surveillance allant du Béarn-vallée d’Aspe au col d’Osquich.
- Altitude : 479m
- Coordonnées : 43°13’38 nord - 0°48’53 ouest
- 140 m d’ouest en est
- 110 m du nord au sud
LE PATRIMOINE
Les insfrastructures

L'école Gaztelaïa
L’Ecole GAZTELAIA propose un enseignement bilingue basque français à parité horaire : sur les 24h d’enseignement hebdomadaire, 12h sont en langue basque. Cela couvre tous les domaines en maternelle, essentiellement les mathématiques et les sciences en primaire. Les parents qui le souhaitent peuvent y scolariser leur enfant dès la maternelle.
Elle a été inaugurée en novembre 2013.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter la page -> Scolarité

Les salles municipales
La Commune dispose de plusieurs salles qu’elle peut louer aux diverses associations ou aux particuliers pour l’organisation de repas et autres festivités. La salle polyvalente peut bien évidemment être louée pour la pratique sportive.
Il s’agit:
- De la salle polyvalente
- Du foyer de la salle polyvalente avec cuisine équipée attenante
- De la salle du C.C.A.S.
- De la salle de l'ancienne école de Hoquy
La demande de réservation doit être faite par courrier adressé à Mme le Maire.

La forêt
La commune de Chéraute est propriétaire de 2 forêts communales qui sont gérées par l’ONF.
L'organisme établis des plans d'aménagements d'une durée de 20 ans. Ceux-ci donnent la ligne conductrice pour l'exploitation de la forêt sur cette durée.
Tous les ans, les travaux à effectuer sont régis parce document.
Il tient compte de beaucoup de paramètres en interaction avec la foret (Topographie et hydrographie, climat, géologie, paysage, accueil, écologie, etc)
Pour la foret de Chéraute, le plan d'aménagement s'étant de 2017 à 2036.

La forêt communale de Chéraute est composée d’un massif principal dit « Bois de Chéraute » et d’un petit massif, ancienne propriété Marcassuzaa, relevant du régime forestier depuis son acquisition par la commune en 2004. Cette forêt couvre aujourd’hui une superficie de 477,53 ha. Il s’agit de la surface planimétrée par le Système d’Information Géographique de l’ONF.
Les altitudes varient de 145m à 555m. La forêt emprunte des caractéristiques aux zones de coteaux et aux zones de piémont. Elle peut être considérée comme une forêt de coteaux excepté dans sa partie sud et ses rebords ouest et est qui s’apparentent plutôt à une zone de piémont, avec des pentes plus fortes.
Le hêtre est l’essence prépondérante dans la forêt puisqu’il occupe les 2/3 de la surface. Il y présente une dynamique particulièrement forte et son pourcentage sur la forêt n’a cessé d’augmenter depuis près de 150 ans, au détriment du chêne pédonculé. Aujourd’hui ce dernier ne couvre plus que 14% de la surface boisée. Il se pose donc le problème de la
disparition à terme du chêne du pays dans la forêt.

Globalement, les potentialités des sols sont moyennes. Le chêne pédonculé ne peut trouver des conditions stationnelles optimales que sur les sols les plus fertiles, bien alimentés en eau.
Sur les versants et croupes où le bilan hydrique est insuffisant, il se trouve dans des conditions écologiques défavorables et présente un risque de dépérissement en cas de sécheresse printanière ou estivale, et a fortiori face aux changements climatiques.

Des dépérissements importants ont déjà été observés sur cette essence, de même que sur le hêtre, à partir de 1982 et jusqu’à la fin des années 1990, à la suite d’épisodes de sécheresse. Le chêne sessile, un autre chêne du pays beaucoup moins exigeant, est l’essence autochtone la mieux adaptée sur les stations de versant. Mais à l’heure actuelle il ne représente que 2% de la surface boisée ; il n’est pas présent dans la forêt à l’âge adulte. Il semble que le hêtre ne pourra être maintenu en tant qu’essence principale objectif que dans la partie sud de la forêt, plus haute en altitude et située dans un petit cirque aux versants pentus exposés au nord. Hors de ce secteur et des stations les plus riches, il conviendra de poursuivre l’enrichissement des régénérations naturelles par plantations de chêne sessile à faible densité.
Les peuplements de chêne rouge occupent 3% de la surface. Les plus âgés sont à régénérer ou sont en cours de régénération.
La forêt présente un excédent de gros bois qui nécessite de poursuivre l’effort de renouvellement déjà consenti au cours de la période précédente.

La production ligneuse est la fonction principale de la forêt. Le massif principal est particulièrement bien desservi, avec de nombreuses places de dépôt ; il a produit sur la période 2001-2015 un volume moyen annuel de 2 565 m3/an, soit 5,44 m3/ha.an. La délivrance en affouage de bois de chauffage pour les habitants de la commune revêt un
caractère important.
Le petit massif dispose de quelques pistes mais sa desserte est inadaptée. La création d’un réseau de pistes efficace et d’une place de dépôt est à prévoir avant toute exploitation.
Globalement sur la forêt, le hêtre et le chêne pédonculé sont de qualité moyenne à bonne. Les meilleures qualités de hêtre se rencontrent dans la partie sud de la forêt, au canton Ahargopea, et les plus beaux chênes se trouvent dans la partie occidentale de la forêt.

La fonction écologique de la forêt présente également un grand intérêt. Les principaux ruisseaux traversant la forêt, notamment le Lausset et le ruisseau Andere, sont inclus dans une Zone Spéciale de Conservation dénommée « Le gave d’Oloron et marais de Labastide-Villefranche » qui ne dispose pas de Document d’Objectif (DOCOB) à ce jour. La surface concernée est d’environ 12 ha. En outre, le massif principal est entièrement concerné par une ZNIEFF de type I (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Faunistique) : « Bois de Sohüta ».

La forêt recèle des habitats d’intérêt communautaire (dont certains d’intérêt prioritaire) : habitats des rives des cours d’eau et sources d’eaux dures (tuffeuses) dans la partie haute de la forêt. Elle abrite des espèces remarquables comme le Pic mar et le Pic noir, le pic epeiche, le pic epeichette, le Petit rhinolophe (chauve-souris), ainsi que l’Écrevisse à pieds blancs, la Lamproie de Planer et la Cordulie à corps fin (libellule) présents au niveau du Lausset.
La prise en compte des enjeux environnementaux nécessite donc de préserver la qualité des eaux des ruisseaux et les ripisylves (peuplements des berges), et de créer des îlots de vieux bois en plus de la trame d’arbres à haute valeur biologique conservés lors des martelages.
Concernant la fonction sociale, les bordures des routes et des chemins de randonnée présentent une sensibilité paysagère plus marquée, de même que quelques secteurs de la forêt exposés au regard extérieur en vision rapprochée. Le document d’aménagement devra prendre en considération l’impact paysager de la gestion forestière plus particulièrement sur les 105 ha concernés.
Par ailleurs, 3 sites archéologiques, des camps de type protohistorique, sont présents à proximité ou à l’intérieur du périmètre forestier, dont celui de Gaztelaia inscrit monument historique depuis 1983 avec périmètre de protection.
